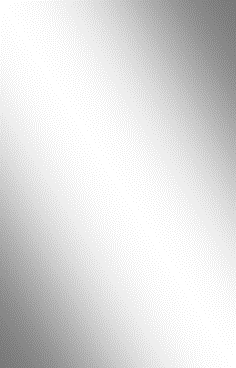
giovanni giannini
1970 - 1995 professeur à l'ensad à paris

La route virevolte littéralement tout au long de la vallée de l’Elsa, au sud-ouest de Florence, lorsque tout à coup, à la sortie d’un virage, apparaissent, baignées d’un soleil irradiant, les superbes tours de San Gimignano qui couronnent une de ces collines toscanes dont on ne se lasse jamais.
Treize tours, oscillant entre le brun rouge et le brun doré, souvenir des soixante-dix tours qui firent, au Moyen-Âge, de San-Gimignano la première ville “gratte-ciel” du monde. Mais il ne s’agissait pas alors d’aller gratter le ciel. Plutôt de s’y opposer ou de le défendre, selon le camp qu’on avait choisi. Deux siècles durant, la guerre civile fit rage dans la petite cité, d’où l’édification de ces tours qui permettaient surveillance, assaut et défenses. Les Gibelins, partisans des empereurs romains germaniques et les Guelfes, partisans des papes et de l’indépendance de l’Italie, s’y déchiraient à belles dents.
“Je suis plutôt Gibelin, confie Giovanni Giannini dans un petit sourire, parce que je suis foncièrement anti-papiste”. Gibelin, certes, Giannini l’est peut-être encore. À preuve, ce goût qu’il a de Dürer et de Goethe, de Mozart et de la philosophie rhénane...
Pourquoi San Gimignano ? C’est que Giovanni Giannini y passe une partie de sa vie depuis vingt ans, dans un appartement atelier situé Piazza della Cisterna, une place de forme triangulaire, entourée de remarquables édifices et de tours massives, majoritairement du XIIIe siècle. Au centre de la place, un puits sublime, du XIIIe lui aussi, qui lui donna son nom, (la citerne) et que Gianninicontemple de ses fenêtres. De quoi exalter le peintre et le coloriste raffiné qu’il est.
San Gimignano donc. Mais aussi Paris et Prague qui jalonnent l’itinéraire de cet homme aux semelles de vent. Prague où il est né, d’une mère tchèque et sculpteur et d’un père italien et officier de marine (ce qui lui vaudra, d’ailleurs, de vivre à Gènes, à la Spezia, à Tarante... au gré des affectations de son père). Prague, où il aime à retourner depuis “la révolution de velours” et où il retrouve Mozart qui y composa son Don Giovanni (justement!), Arcimboldo qui y peignit l’essentiel de son oeuvre et cette architecture baroque “si pleine, si gaie, si généreuse qu’elle m’emplit de joie”. Paris où il débarque en 1949, à l’âge de dix-neuf ans pour s’inscrire, déjà, à l’École des arts décoratifs. Quatre ans plus tard, il en sort diplômé major de sa promotion. Dès 1953, sa carrière démarre sur deux axes : peintre et illustrateur. Il ne cessera jamais de cultiver ces deux aspects d’une même vision : “la peinture, c’est très angoissant, c’est un voyage dans l’inconnu. L’illustration, c’est autre chose, comme un voyage préparé, projeté, avec un texte qui sert de guide”.
Giannini le peintre expose ; à Paris, à Milan, à Copenhague, à Venise, à Brescia, à Londres, à Stockholm, à Lisbonne, à Montevideo, à Vérone... et, biensûr, à San Gimignano.
Giannini l’illustrateur produit plus de cent livres, publiés chez Flammarion, chez Hachette, chez Mondadori, chez Nathan, chez Fabbri... et parmi lesquels Les Mille et une nuits, Les Contes Russes ainsi que Le Livre du Ver à Soie qui lui valut le Prix Saint-Exupéry en 1993, aux Livres du Dragon d’or ; il est enfin l’auteur d’une série de gravures sur cuivre pour Michel de l’Ormeraie pour lequel il illustre Gordon Pym et Les Histoires Extraordinaires de Edgar Poe, Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll et Les Contes d’Andersen.
Tant il est vrai que ces titres illustrent bien, à leur tour, l’univers, l’imaginaire de GIANNINI, tour à tour épique, romantique, fantastique... Faut-il voir là le résultat du télescopage entre Bohême et Toscane ? Sans doute en partie, d’autant que les références, les amitiés, les affinités du peintre et de l’illustrateur fonctionnent elles aussi à la manière d’un collage, unissant au gré du moment et de l’humeur, Giotto et Dostoïevsky, Velasquez et Palladio, Léger et Tchékov, Picasso et Goethe, Léonard de Vinci et Gogol, Goya et Santini, le Gréco et Cézanne... bref un mélange savamment composé de Renaissance italienne, de baroque germanique, de siècle d’or espagnol, de modernité française, tout ce qui entraîne au rêve et à la fantaisie.
En 1970, GIANNINI réapparaît rue d’Ulm. Il devient professeur dans son ancienne école. Il y crée le département illustration. À peine deux ans plus tard, il organise l’exposition à l’école des travaux de ses élèves. Première du genre, elle deviendra vite un exemple et, exposition après exposition, donnera finalement naissance aux “Portes Ouvertes” annuelles de l’E.N.S.A.D.
GIOVANNI GIANNINI se lance à corps perdu dans l’enseignement, comme il l’a fait pour la peinture ou l’illustration. Douze heures par semaines, trois années (deuxième, troisième et quatrième) couvertes et une moyenne de soixante étudiants par an. Soit, en vingt-cinq ans, plus de mille cinq cents étudiants formés par ses soins ! “et qui tous, aujourd’hui, travaillent !” confie-t-il avec un peu de fierté et d’émotion dans la voix. Son territoire, à l’École, c’est l’illustration éditoriale : “un territoire vaste, ou plutôt des territoires, puisque cela concerne aussi bien l’édition littéraire que le livre pour enfants, mais aussi le dessin, la gravure, le graphisme, la typographie, la peinture, la bande dessinée, l’illustration de presse, le décor de théatre... Parce qu’il s’agit, dans un tel enseignement, de toucher à tout en toute liberté, d’apprendre la base, toutes les bases aux étudiants. Ce qu’ils en feront, c’est à eux de le décider, de le choisir. À nous aussi de leur apprendre à bien saisir les limites qui existent entre rigueur et fantaisie, contraintes et liberté”.
Chaque fois qu’il le peut, GIANNINI montre son travail à ses étudiants. Expositions, livres, projets, tout y passe. Manière pour lui de démontrer l’usage qu’il fait des techniques qu’il leur enseigne. Manière de courtoisie également, de se présenter, de se remettre en cause, de prendre des risques. “Enseigner, dit-il, c’est formidablement stimulant, c’est se surpasser, rester sur la crête de la vague. Les étudiants ne s’en rendent pas compte, mais ils nous apprennent tout autant que nous leur apprenons...”
Au delà de la démonstration de courtoisie, ce que GIANNINI opère par cette présentation, c’est une première mise en place : “leur apprendre à faire un dossier, c’est capital. Ce n’est pas à la vue d’un diplôme qu’un éditeur leur confiera un travail. Mais bien à la vue d’un dossier, présenté, organisé, abouti. C’est pour cela que nous insistons tant pour leur faire réaliser des livres entiers, qu’ils choisissent eux-mêmes, afin que s’exprime non seulement leur savoir-faire, mais également leur personnalité”.
Ainsi s’articule la trilogie qui sous-tend tout l’enseignement de GIOVANNI GIANNINI : l’éducation de l’oeil, la stimulation intellectuelle, le pragmatisme professionnel.
En juin dernier, GIOVANNI GIANNINI devait partir à la retraite. Quitter l’École, et se consacrer exclusivement à sa peinture et à ses illustrations. Mais les circonstances en ont décidé autrement. GIANNINI rempile pour un an. On le verra donc encore arpenter la rue d’Ulm et les couloirs de l’École. “Un an encore, oui, mais seulement en deuxième année et avec beaucoup moins d’heures”, soupire-t-il, mais avec une lueur de ravissement au coin de l’oeil. GIANNINI assure la transition. Une année supplémentaire, même réduite, histoire de donner envie aux nouveaux étudiants de continuer, histoire de passer le flambeau dans les meilleures conditions possibles à XAVIER PANGAUD qui fut, successivement, son étudiant puis son assistant, qui va poursuivre son oeuvre à la tête du département illustration.
En juin 1996, GIOVANNI GIANNINI quittera la rue d’Ulm et chaussera à nouveau ses semelles de vent. Et se partagera tout à loisir entre Paris, Prague et San Gimignano. Trois villes d’une beauté exceptionnelle et qui continueront d’entretenir sa trilogie personnelle : l’éducation de l’oeil, la stimulation intellectuelle et le pragmatisme professionnel.
l'homme aux semelles de vent
article de Gilles de Bures,
paru en octobre 1995 dans le Journal de l’ensad
(École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs).
%20copia.jpg)

Gilles de Bures